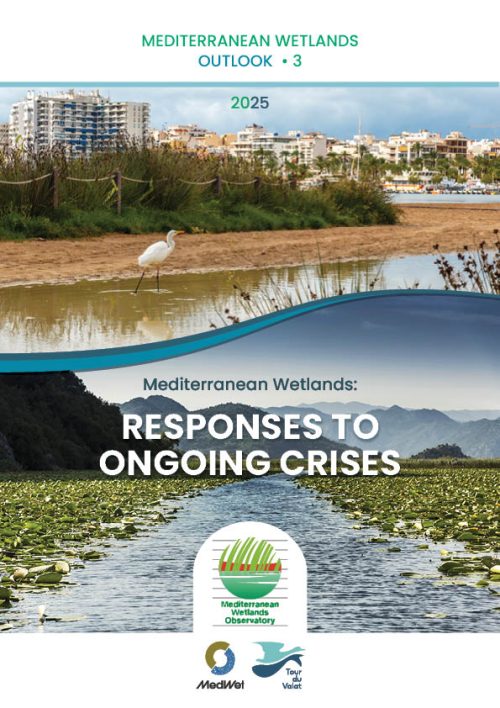
Des réponses face aux crises : la troisième édition du Mediterranean Wetlands Outlook est publiée !
Actualités
Découvrez le rapport complet du Mediterranean Wetlands Outlook 3 ici !
Une région sous pression
La Méditerranée traverse une période de bouleversements : pression démographique, urbanisation rapide, surexploitation des ressources, crise climatique. Dans ce contexte, les zones humides jouent un rôle vital pour la régulation de l’eau, la biodiversité, la protection contre les inondations et le bien-être des populations.
Le Mediterranean Wetlands Outlook 3 (MWO-3), publié à l’occasion de la 15ᵉ Conférence des Parties de la Convention de Ramsar (Victoria Falls, Zimbabwe, 2025), propose un panorama actualisé et opérationnel des dynamiques qui affectent ces milieux essentiels.
Ce rapport de référence est développé par l'Observatoire Méditérannéen des Zones Humides, avec la contribution de nombreux partenaires scientifiques et institutionnels.
Un diagnostic rigoureux
Les constats sont frappants :
- Près de 56 % des zones humides historiques ont déjà disparu ; Depuis 1990, les zones humides naturelles restantes ont perdu environ 12 % de leur surface ;
- 95 % des grands réseaux fluviaux sont aujourd’hui fragmentés ;
- Et la qualité de l’eau demeure insuffisante pour près de la moitié des masses d’eau de la région.
Ces tendances traduisent la combinaison de pressions majeures : expansion urbaine, intensification agricole, surexploitation des ressources hydriques et impacts du changement climatique. Elles menacent directement des écosystèmes essentiels à la stabilité environnementale et sociale du bassin.
Un cadre d’analyse solide pour comprendre et agir
Le MWO-3 s’appuie sur 18 indicateurs structurés selon le modèle DPSIR (Drivers – Pressures – State – Impacts – Responses), un outil d’évaluation environnementale permettant de relier les causes profondes, les pressions observées, l’état des milieux et les réponses mises en œuvre.
L’analyse couvre les 28 pays membres de l’Initiative MedWet, regroupés en quatre sous-régions : le Maghreb, le Moyen-Orient, les Balkans et l’Europe du Sud-Ouest. Cette approche permet de suivre les grandes tendances tout en mettant en évidence les disparités de gouvernance et de capacités entre les rives nord et sud du bassin.
Le rapport est structuré en trois volets :
- Une synthèse technique présentant les tendances observées, les enseignements des 18 indicateurs DPSIR et les grands moteurs de changement ;
- Des recommandations articulées autour de cinq leviers d’action pour orienter les politiques publiques, appuyer les gestionnaires de sites et mobiliser les acteurs de terrain ;
- Des fiches indicateurs détaillées, offrant des résultats structurés et des interprétations claires pour chaque paramètre analysé.
Cinq leviers pour inverser la tendance
L’un des apports majeurs du MWO-3 réside dans l’identification de cinq leviers stratégiques pour freiner la dégradation des zones humides et renforcer leur rôle dans la transition écologique :
- Repenser l’aménagement du territoire, en intégrant les zones humides comme infrastructures naturelles ;
- Faire de la politique de l’eau un levier transversal, fondé sur l’équilibre entre usages humains et besoins écologiques ;
- Accélérer la restauration écologique, avec près de 88 000 km² de zones potentiellement restaurables à faible coût dans les pays du nord du bassin ;
- Renforcer la gouvernance et la coopération régionale, en consolidant les institutions environnementales ;
- Encourager l’engagement citoyen et les initiatives locales, condition essentielle à la durabilité des transitions.
Le cas du Sebou Water Fund : un exemple d’action intégrée
Parmi les initiatives exemplaires mises en avant dans le rapport figure le Sebou Water Fund (Maroc), un mécanisme de financement durable pour la conservation et la restauration des écosystèmes d’eau douce dans le bassin du Sebou. Ce dispositif est coordonné par Living Planet Morocco et soutenu par le DIMFE, via le projet Upscale Sebou Water Fund.
Il repose sur un principe simple : les usagers de l’eau en aval (entreprises, services publics, collectivités) contribuent financièrement à des actions de restauration et de gestion durable dans les zones situées en amont. Ces activités (reforestation, lutte contre l’érosion, gestion des terres agricoles) améliorent la qualité de l’eau, favorisent la recharge des nappes et soutiennent les communautés locales. Ce modèle illustre parfaitement comment la collaboration entre acteurs publics, privés et associatifs peut concilier développement local et résilience écologique.
Un appel à l’action collective
Au-delà du diagnostic, le Mediterranean Wetlands Outlook 3 appelle à une mobilisation collective : décideurs, scientifiques, collectivités, organisations de la société civile et citoyens doivent unir leurs efforts pour replacer les zones humides au cœur des stratégies de résilience climatique, hydrique et territoriale.
Le rapport se veut un outil d’aide à la décision et de plaidoyer, offrant une base scientifique solide pour concevoir des politiques publiques ambitieuses, renforcer la coopération entre pays méditerranéens et soutenir la mise en œuvre des engagements internationaux, notamment ceux de la Convention de Ramsar et du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal.